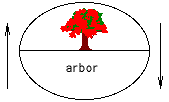
Selon Prieto, un signe est une entité signal/sens. Le signal, partie signifiante du signe, est le vecteur perceptible, dans un acte de communication, venant de l'émetteur. Le sens, produit (ou déduit) du récepteur, est la partie "non matérielle" du signe, sa partie signifiée. "Le terme de signe est utilisé en général pour toute entité "bifaciale" formée d'une classe de signaux et d'une classe de sens corrélatives entre elles, par des classes telles que l'appartenance du signal produit par l'émetteur à la première implique l'appartenance de ce qu'il "veut dire" à la seconde."
Ainsi définis, ces trois éléments méritent quelques explications supplémentaires. Se situant dans une linguistique saussurienne, Prieto étend la notion de "signe" à tout acte de communication. Saussure affirmait que "le signe linguistique unit non une chose et un nom, mais un concept et une image acoustique" (Cours de linguistique générale, p. 98). A ce propos, il faut remarquer que "l'image acoustique" en question n'est pas un élément seulement matériel, mais une "représentation naturelle du mot en tant que fait de langage virtuel, en dehors de toute réalisation par la parole" (note de l'éditeur, in: Cours de linguistique générale, p. 98). L'image acoustique de Saussure est donc une définition générale ayant un "caractère psychique" (on peut se réciter des vers sans remuer les lèvres).
Saussure propose de remplacer "image acoustique" et "concept" par signifiant et signifié, l'ensemble des deux formant le signe. Cette définition nous sera plus utile, car elle nous permettra de transposer ces notions dans ces autres outils de communication que sont (par exemple) les images.
Dans la langue, Saussure donne quelques exemples montrant la distinction qu'il entend entre "image acoustique" et "concept". Ainsi, il fait un petit schéma illustrant la relation existant entre le mot latin "arbor" et le concept d'arbre qu'il porte (figure ci-dessous).
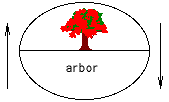
Ainsi, si l'on appellera parfois le mot "arbor" un signe linguistique, il faura se souvenir que cet "arbor" est indissolublement lié au "concept d'arbre". Certains auteurs (je cite de mémoire) ont d'ailleurs souligné que la connaissance de la réalité extérieure était précisément possible parce que tout objet renvoie à un signifié, concept qui médiatise la relation avec l'extériorité. On n'est pas dans une connaissance directe de la réalité extérieure (figure ci-dessous à gauche), mais dans une relation de connaissance médiatisée par un appareil conceptuel nous permettant de saisir la réalité (figure ci-dessous à droite).

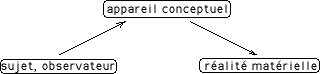
Saussure attribuait deux caractères primordiaux au signe: l'arbitraire du signe et le caractère linéaire du signifiant (voir ce qui avait été discuté en classe).
Très tôt, la notion de signe a été transposé de la linguistique dans la graphique et dans l'ensemble des sciences de la communication. Saussure lui-même mentionnait les signaux maritimes, mais n'approfondissait pas davantage la notion de signe graphique.
Il est cependant aisé de définir le signe graphique comme une entité bifaciale, la face signifiante étant une image ou un élément d'image, la face signifiée étant analogue au "concept" défini précédemment. Le caractère linéaire du signifiant n'est bien sûr plus réalisé, puisque l'image joue sur la synchronie, alors que la langue repose sur la diachronie.
En cartographie, chaque signe présentant un élément du territoire porte nécessairement ces deux faces, signifiant et signifié. Ainsi, un cercle de 2 cm de diamètre (niveau signifiant) pourra indiquer une population de 100'000 habitants à cet endroit dans le territoire. C'est cependant en regardant la carte de façon globale (niveau supérieur de lecture) que l'ensemble pourra montrer la combinaison des signes, et exprimer ainsi des sens dérivés résultant du dialogue des éléments présentés.
C'est ce que semblent oublier les chercheurs utilisant les chorèmes (figures élémentaires -schématiques- de l'espace, combinées sur des cartes): l'accumulation de signaux (signifiants) fait perdre au lecteur le sens général. L'élaboration du signifiant global devrait s'accompagner de celle du signifié "en sélectionnant des sens pertinents parmi ceux mis en évidence, en visant à dégager un sens nouveau, complexe et composite, toutefois explicite, synthétique et global, justifiant l'association de signaux lisibles en un chorème final" (Hussy, op.cit., p. 29).
Je me suis entièrement basé, dans cette fiche, sur des conception saussuriennes. L'essentiel de ces considérations ne sont généralement pas remises encause par les autres auteurs. Tout au plus trouve-t-on des différences de terminologie, comme nous en avions discuté en classe. Pour ma part, je préfère adopter cette terminologie-ci, l'utilisation de "symbole" à la place de "signe", par exemple, me paraissant prêter davantage à confusion (le langage courant utilise le mot "symbole" dans une acception assez restreinte, dans laquelle le lien naturel entre le signifié et le signifiant entre en compte).
A ce propos, Hussy souligne d'ailleurs que l'étymologie grecque du mot "symbole" devrait nous conduire dans cette voie: "sûn", avec, et "bolon", objet disposé, mis; "le bâton brisé signifie la réunion de deux êtres, la reconnaissance mutuelle par rassemblement des deux fragments, d'où le sens "distincts, mais inséparables pour toujours". Généralisant cette étymologie, on entend par symbole un signe dont signifiant et signifié sont considérés comme intrinsèquement associés ou complémentaires." (La carte: un modèle, un langage, p. 20)
Retour à la page d'index de staf13
Grégoire Métral